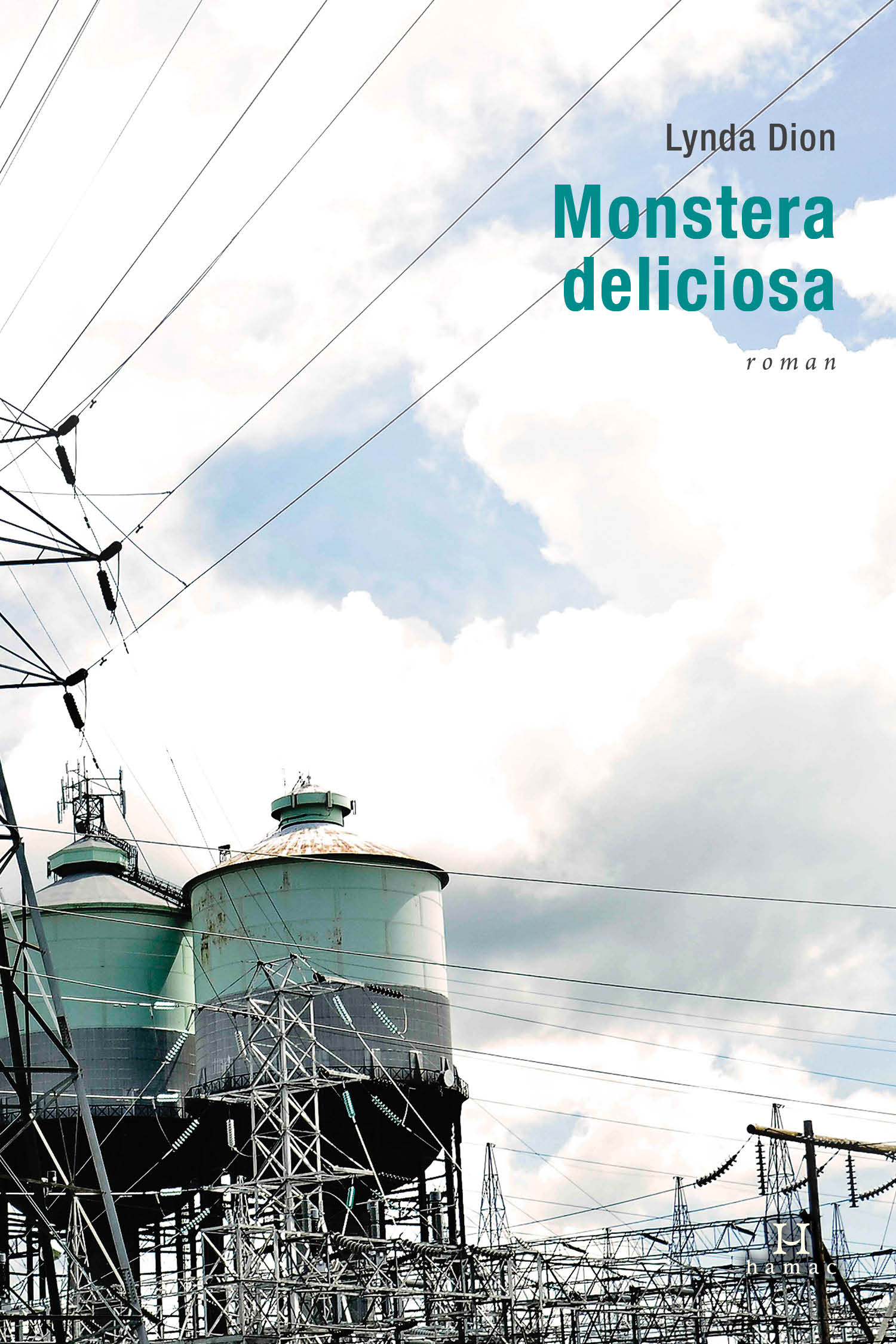HUIT FOIS PAR ANNÉE, NOTRE RÉDACTRICE EN CHEF CONSACRERA QUELQUES LIGNES À L'ENSEMBLE DE L'ŒUVRE D'UN AUTEUR OU D'UNE AUTRICE D'ICI DONT ELLE A FAIT LA DÉCOUVERTE, OU DONT ELLE JUGE QUE LE TRAVAIL DEVRAIT ÊTRE DAVANTAGE CONNU...

HUIT FOIS PAR ANNÉE, NOTRE RÉDACTRICE EN CHEF CONSACRERA QUELQUES LIGNES À L'ENSEMBLE DE L'ŒUVRE D'UN AUTEUR OU D'UNE AUTRICE D'ICI DONT ELLE A FAIT LA DÉCOUVERTE, OU DONT ELLE JUGE QUE LE TRAVAIL DEVRAIT ÊTRE DAVANTAGE CONNU...
Autobiographie ? Non, c’est un privilège réservé aux importants de ce monde, au soir de leur vie, et dans un beau style. Fiction, d’événements et de faits strictement réels ; si l’on veut, autofiction, d’avoir confié le langage d’une aventure à l’aventure du langage...
Serge Doubrovsky (1928-2017)
Je défends depuis des années l’autofiction et cette manière qu’elle peut avoir de nous dire beaucoup de choses importantes sur ce que c’est que d’écrire, de publier, d’être lu, reçu. Cette manière qu’elle peut avoir de nous tendre un miroir dans lequel se reflète une part de notre humanité, qui que nous soyons.
Je défends depuis des années le fait que l’autofiction, contrairement à l’autobiographie, est un genre littéraire démocratique – c’est sans doute une des causes de la résistance qu’on lui oppose parfois. L’autofiction est accessible à tous et toutes, et pas seulement aux « importants de ce monde », pour reprendre les mots de Doubrovsky. Elle est même parfois un lieu où peut enfin retentir la voix des sans-voix, un lieu d’expression, de réflexion pour des personnes qui, autrement, n’auraient pas eu accès aux tribunes littéraires du je. (C’est d’ailleurs l’un des objets de la thèse de doctorat de l’écrivaine et professeure québécoise Karine Rosso, que j’ai eu le privilège de lire à l’occasion de sa soutenance.)
Peu d’œuvres autofictionnelles m’ont autant bouleversée, malgré des dizaines de relectures (je lui ai consacré ma thèse puis un essai), que celle de Serge Doubrovsky, l’écrivain français qui a inventé l’étiquette « autofiction » en 1977.
Lire Doubrovsky, c’est lire le parcours d’un écrivain et professeur français de parents russes et juifs, né en 1928, et ses relations complexes avec femmes, lecteurs et lectrices, son rapport à l’écriture et à la publication, au succès, au scandale… le tout avec, en arrière-plan, l’histoire de la France du XXe siècle et son apothéose cauchemardesque, la Shoah. Parce que Serge Doubrovsky est juif et qu’il a dû porter l’étoile jaune, qu’il a échappé de justesse à la déportation, son rapport à la littérature et au monde est irrémédiablement infléchi.
Et au-delà, il y a la forme des autofictions doubrovskiennes. Cette langue haletante qui joue avec la ponctuation, les majuscules, les italiques. Cette voix qui met en scène le geste d’écrire de l’autofiction, et ses conséquences, au sein même des autofictions.
Il y a enfin ce miroir tendu aux lecteurs et, contrairement à ce qu’on a pu dire, bien au-delà du supposé narcissisme des autofictionnistes, ce don de soi et cette recherche du point de rencontre entre soi et l’autre. Cette main tendue.
*
Pourquoi ce long détour par Serge Doubrovsky, dont j’espère néanmoins qu’il donnera envie de le lire ? C’est simple : j’avais renoncé à ce qu’une œuvre autofictionnelle vienne me chercher et me secouer de manière aussi profonde et viscérale… jusqu’à ce que je lise les livres de Lynda Dion, La Dévorante (2011), La Maîtresse (2013), Monstera deliciosa (2015) et Grosse (2018).
*
écrire est un mouvement en forme de spirale chaque cercle chaque livre élargit le précédent on part ou on revient toujours au centre le noyau dur de ce qu’il y a à dire le dénominateur commun entre soi et les autres (Grosse)
D’abord, il y a eu la découverte d’une voix. La voix de Lynda Dion qui trouve son essence dans un jeu avec la ponctuation, un jeu sur le rythme, le souffle, les limites imposées par une grammaire « correcte », et qui a quelque chose de foncièrement doubrovskien. On trouve chez Dion comme chez Doubrovsky une façon de tordre la langue pour lui faire dire plus que ce qu’on la croit capable de dire.
Inutile de préciser que pour y parvenir comme le faisait Doubrovsky…
(Rencontres, fils des mots, allitérations, assonances, dissonances, écriture d’avant ou d’après littérature, concrète, comme on dit musique. Ou encore, autofriction, patiemment onaniste, qui espère faire maintenant partager son plaisir.)
… ou comme le fait Lynda Dion…
(c’est comme ça la virgule pour moi elle ralentit elle stoppe l’élan découpe la phrase déroulée comme une bobine de fil dans le labyrinthe)
(La Maîtresse)
… il faut d’abord avoir une furieuse maîtrise de la langue et de ce qui, en elle, peut faire frein à l’écriture autofictionnelle, voire littéraire, de ce qui en elle peut être défait, pour l’ouvrir là où elle semblait fermée.
*
On trouve au sein même de La Dévorante, La Maîtresse, Monstera deliciosa et Grosse une réflexion sur leur lecture, leur réception, leur inscription dans la littérature et les genres reconnus. Et ce cri de l’autrice qui défend le droit à une littérature autre que celle déjà balisée, une littérature qui fait ce pour quoi la littérature est faite : faire sauter les frontières, ou du moins les rendre poreuses.
L’autofictionniste que je défends bec et ongles est celui ou celle qui rappelle que le fait de choisir cette pratique, contrairement à ce qu’on a parfois voulu dire, n’est pas strictement narcissique. Que ça ne l’est peut-être même pas du tout. Qu’il s’agit surtout d’une nécessité littéraire, d’une nécessité esthétique : trouver une forme qui sache dire.
j’entends la critique une certaine critique qui exècre l’écriture du moi l’écriture autoréférentielle réputée narcissique maniérée sans invention
c’est vrai que je suis sans imagination j’écris à partir du réel le mien puisque je n’en connais pas d’autre qui soit plus accessible immédiat énigmatique
presque étranger
c’est moi et ce n’est pas moi cette femme qui a commencé à se raconter et cette distance entre les deux m’aide à vivre à donner un sens
à rester dans la vie
je creuse je fouille j’interprète je suis la matière première de ce que j’écris (La Maîtresse)
En ici, en écho, j’entends les mots d’un certain Michel de Montaigne dans ses Essais (« Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre… »), sur lequel s’appuyait également Serge Doubrovsky.
Plutôt que voir l’autofiction comme l’affaire d’un je qui s’expose, on pourrait la voir comme l’affaire d’un je qui s’offre à ses semblables, pour jeter des ponts, pour basculer dans une humanité partagée. Non pas un miroir de soi qui permet à l’autofictionniste de montrer à sa lectrice, son lecteur, son propre reflet… mais un miroir double, un miroir magique, dans lequel auteur·rice autant que lecteur·rice peuvent se reconnaître, chacun, et mutuellement.
On écrit au je parce que :
Chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition (Montaigne)
Et porté par :
l’espoir insensé de ne pas être seule à la fin (Dion)
*
Ne pas être seule à la fin, c’est ce qui m’est arrivé, dans mon humaine condition de femme qui n’est plus une jeune première et qui rencontre peu de femmes qui lui ressemblent tant chez les autrices mises de l’avant par les milieux littéraires et médiatiques que dans les héroïnes que nous présentent cinéma, télévision, roman, etc.
en fait le problème n’est pas là pas dans la photo ni dans le passé ni dans l’avenir il est dans l’œil qui regarde le corps qui le surveille le scrute le fouille l’examine l’ausculte le détaille le réprimande le sermonne l’accuse le déteste le maudit l’exècre l’abomine le dénigre le condamne l’agresse le démolit jour après jour (Grosse)
On me dira que tout ça est quand même un peu en train de changer, et c’est vrai. Mais c’est notamment grâce au travail d’autrices comme Lynda Dion, dont un chapitre d’une de ses autofictions commence ainsi, sur un sujet non seulement tabou dans la vraie vie, mais peu abordé en littérature et dans notre société — si bien que celles qui le vivent ressentent une infinie solitude, une sorte d’incompétence face à leur propre corps, voire une détresse :
La ménopause. Les graines de lin et le lait de soja tous les matins avant quoi que ce soit d’autre pour célébrer le grand désordre hormonal le corps ne fait plus les choses comme avant c’est tant mieux se dit le cœur qui a pompé son lot de grosses peines l’amour est tranquille ça nous laisse un peu de temps pour refaire nos forces
je n’ai pas écrit le dernier mot pourtant
[…]
c’est maintenant les grandes chaleurs les suées nocturnes le dépistage du cancer du sein le lit désert les vendredis soirs à manger des sushis et à boire du rosé toute seule toute la bouteille pas besoin de partager ni la fiole ni le lit c’est mieux parce que l’alcool ça me donne chaud
ça me fait pisser des larmes et mouiller mes draps.
Ces mots de La Dévorante font partie d’un fil qui court tout au long de l’œuvre de Lynda Dion, le fil de ce que c’est que d’être une femme qui prend de l’âge, qui veut aimer, qui veut s’aimer, qui aimerait savoir se regarder autrement qu’avec ses propres yeux (« il faudrait peut-être qu’on m’arrache les yeux pour que je puisse enfin me trouver belle », dit-elle dans Grosse), une femme qui aimerait en témoigner et l’écrire. Écrire le monde qui n’a jamais épargné et n’épargnera jamais les femmes, sauf si elles se conforment le plus possible au silence qu’on attend d’elles, au corps (peu visible car qui prend peu de place) qu’on attend d’elles, à la parole (insignifiante) qu’on attend d’elles — comme elle n’a jamais épargné, chez Serge Doubrovsky, les Juifs, chez Hervé Guibert, les homosexuels ou les personnes atteintes du SIDA, chez Chris Bergeron ou Gabrielle Boulianne-Tremblay, les personnes trans, chez Marie-Pier Lafontaine les femmes qui ont été victimes de violences familiales, pour ne donner que quelques exemples…
*
Une histoire vieille comme le monde.
Commune. Presque banale à force.
C’est un dimanche, fin janvier.
On pourrait penser de Monstera deliciosa qu’il s’agit d’un ovni au sein de l’œuvre de Lynda Dion.
Je, il ne faut pas. Écrire à côté : la troisième personne, c’est mieux pour ce qu’il y a à dire.
Le roman n’est en effet pas écrit à la première personne, il est « correctement » ponctué… Mais il ne s’en inscrit pas moins dans l’ensemble d’une œuvre, d’un parcours, et de manière très nette.
Elle y repense souvent. Des détails gros comme un édifice de trente étages. Ses courriels bourrés de fautes. Cette façon de chuinter en disant le mot s(ch)upposé. Et son côté verbomoteur. Il n’y avait de place pour personne d’autre quand il occupait la parole. Des détails qui n’allaient rien empêcher. Du moment qu’on veut l’amour, on le trouve. Tant pis si le candidat n’a pas l’étoffe attendue, ou le physique de l’emploi.
On se dit qu’on n’est pas soi-même parfait. Et qu’il faut bien faire des compromis si on ne veut pas rester seul.
Monstera deliciosa aborde des questions on ne peut plus universelles et ici encore, j’ai été sidérée par le rapprochement à faire avec Serge Doubrovsky qui, dans Un amour de soi (1982), rend hommage à la fameuse phrase de Proust dans laquelle Charles Swann, ayant rompu après des années d’une relation torturée avec Odette de Crécy, s’exclame, avec une sorte d’arrogance crasse et oublieuse de l’homme maladivement épris qu’il a été :
« Dire que j’ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour, pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre! » (Marcel Proust, Un amour de Swann)
Chez Lynda Dion, le rapport est inversé. Un homme peut être Odette de Crécy et une femme Charles Swann.
*
Enfin, on en arrive à l’apothéose des quatre romans de Lynda Dion, qui est aussi une autre pierre dans un édifice qui n’a pas fini de se construire, je l’espère : Grosse (2018), dont on a beaucoup parlé pour sa dénonciation sans compromis de la grossophobie dans notre société, et qui poursuit tous les thèmes abordés dans les précédents romans, autour d’un personnage féminin qui rappelle le héros doubrovskien.
l’ostie de grosse vache se meurt d’envie d’expulser sa colère dans un grand flot de phrases détachées rompre les cordons par lesquels l’ennemi grimpe et prolifère comme la peste
On en revient ici à la littérature au je comme lieu capable de « porter l’humaine condition ». Mieux : dans sa charge contre le carcan qu’on impose aux femmes, et sans jamais faire de compromis quant au fait que notre monde en impose surtout, d’abord et avant tout, de manière nette et flagrante, aux femmes, Lynda Dion va où peu d’autrices sont allées. Dans un élan vers l’autre qui a quelque chose de généreux et de profondément humaniste, elle pose la question de la souffrance de l’homme dans ce monde qui est un carcan pour les femmes. Car comme le disait James Baldwin au sujet du rapport entre Blancs et Noirs aux États-Unis, le rapport occidental hommes-femmes est un carcan, il est une prison dans laquelle l’un comme l’autre, victime comme bourreau, dominateur comme dominée, sont enfermés. L’un contre l’autre dans le sens d’en opposition, mais aussi dans le sens de « tout près », comme on dirait « l’un tout contre l’autre ».
D’accord je suis grosse mais encore
comme je suis aussi une personne de sexe féminin je me demande
la question se pose et elle est plutôt intéressante
est-ce que les hommes qui sont gros s’en font avec leur apparence est-ce qu’ils ont honte est-ce qu’ils ressentent de la pression comme les femmes qui ne cadrent pas dans les stéréotypes est-ce qu’ils éprouvent du dégoût pour leur corps est-ce qu’ils sont obsédés par leur image est-ce qu’ils craignent d’exposer leur corps pendant l’amour est-ce qu’ils s’inquiètent d’être remplacés par un mâle plus attirant est-ce qu’ils font des régimes à répétition est-ce qu’ils mangent en cachette est-ce qu’ils se soucient des vêtements qu’ils portent pour mieux paraître est-ce qu’ils fuient les plages pour ne pas avoir à montrer leur corps en public
est-ce qu’ils arrivent à se convaincre qu’ils ne sont pas qu’un corps ?
Je ne le sais pas, et peut-être certains pourront-ils, après avoir lu ce billet, aller lire les ouvrages de Lynda Dion et nous le dire.
Mais une chose est certaine, l’œuvre de cette autrice, trop peu connue en dehors de Grosse, a énormément à nous dire sur le pouvoir des autofictions qui explorent les replis du réel et de l’âme humaine, les replis de l’âme sociale et historique, en tant qu’objets foncièrement littéraires non seulement par l’ambition et le propos, mais également par la forme.
je ne fais pas de la littérature c’est elle qui me fait me structure me construit m’apprend à vivre c’est à cause d’elle si je m’expose sans tricherie et que je prends tous les risques (Grosse)
Tous les risques, oui, pour dire un monde et une humanité qui sont aussi — et tout autant que ceux de Lynda Dion l’autrice, la narratrice, le personnage — les nôtres. Il ne me reste qu’à souhaiter de pouvoir retrouver bientôt cette héroïne à laquelle je suis si attachée, et de continuer à la suivre, inlassablement et sur des années, tout au long de sa vie de papier.
Livres de Lynda Dion:

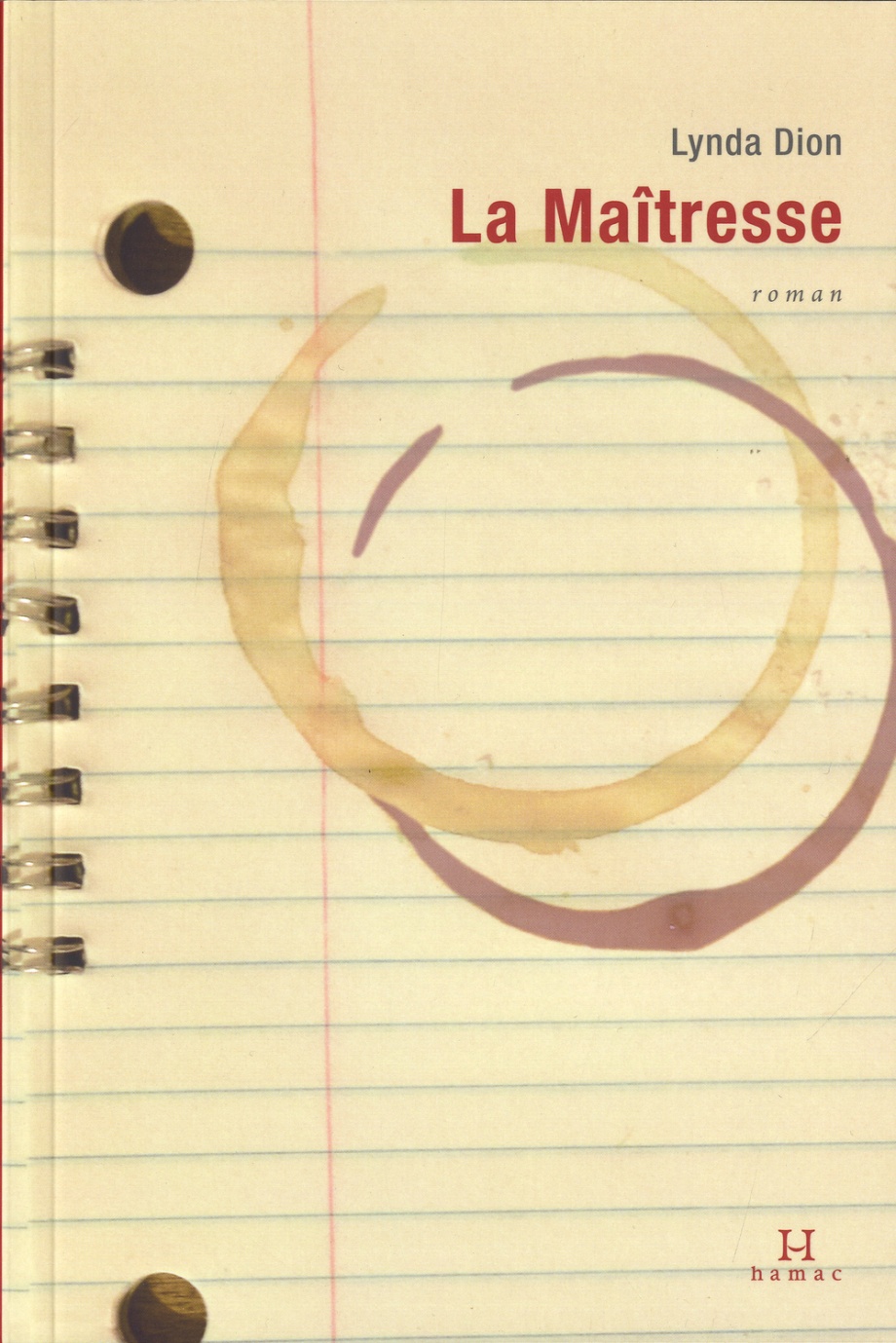
Monstera deliciosa, Hamac, 2015.